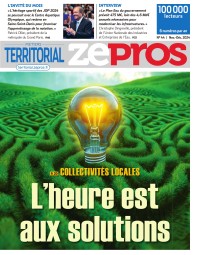L’émancipation des régions

Triste campagne des régionales très politisées et loin des réels enjeux territoriaux en présence.
Pour les élections départementales et régionales qui se tiennent les 20 et 27 juin, on parle beaucoup (trop) de sécurité alors qu’il ne s’agit pas d’une compétence des régions. Dans ce contexte, l’étude que vient de publier l’Institut Montaigne , intitulée « Régions : le renouveau de l'action publique ? », permet de prendre du recul en abordant les vrais sujets mais aussi en montrant l’évolution forte, voire l’émancipation, de cet échelon de collectivité. Elle dresse un bilan du premier mandat régional depuis les fusions de 2015 (loi du 16 janvier 2015). Parfois perçues comme trop vastes, les nouvelles régions ont pourtant affirmé leur dimension politique et fait preuve d’innovation en matière d’action publique. L’Institut Montaigne estime ainsi que les régions sont devenues de réels laboratoires de la transformation publique, évitant l’écueil de regroupements les technocratisant encore davantage. L’étude a été réalisée par Nicolas Bauquet, historien et directeur délégué de l’Institut Montaigne, avec plus de 150 entretiens menés de février à avril 2021.
Une forte concentration de pouvoir
Premier constat : le président de région, son directeur de cabinet et le DGS forment un trio qui concentre un pouvoir très étendu. Tout en gérant des budgets conséquents, le président reste bien un élu local, en lien direct avec les citoyens, proche de son territoire. « Le modèle institutionnel régional est donc marqué par une extrême concentration du pouvoir qui vient de la transposition du modèle municipal à l’échelon régional », estime l’étude. Venant de l’État (ENA, écoles d’ingénieurs, Trésor Public), de la FPT voire du monde universitaire, les hauts fonctionnaires régionaux se définissent comme « des entrepreneurs publics au plus près du pourquoi ». Selon l’un d’entre eux, « la région apparaît comme le lieu de refondation d’une autre action publique. Un lieu où l’on retrouve le sentiment de pouvoir créer, inventer, écrire une nouvelle histoire ».
L’action publique régionale se partage entre deux couples clés : préfet et président de région, SGAR (secrétaire général pour les affaires régionales) et DGS. La crise sanitaire a montré leur mobilisation conjointe, notamment pour relayer les dispositifs d’aide aux entreprises, identifier les plus fragiles, combler les failles entre les différents dispositifs.... Au niveau national, la période est marquée par des coopérations inédites avec surtout deux ministères (Cohésion des territoires, Économie et des finances). La gestion de la crise et la mise en œuvre du plan de relance montrent l’importance « cruciale » de la transversalité entre les ministères et en leur sein pour développer un dialogue stratégique avec les régions, notamment dans le cadre des négociations des contrats de plan État-région (CPER). L’étude plaide ici pour « créer de nouveaux lieux de travail en commun, mais aussi hybrider les cultures et croiser les parcours ».
Des laboratoires de la transformation publique
Circulation de l’information, circuits de validation, enjeux de transversalité, autant de questions qui se posent pour les nouvelles régions fusionnées après 2016. Certaines en ont profité pour engager des transformations profondes de leur administration. Par exemple, en Nouvelle Aquitaine, une délégation générale à la transformation, au pilotage et à la modernisation (DGTPM), placée directement auprès du DGS, a été créée pour conduire la transformation managériale. Dans le Grand Est, un livre blanc sur la transformation numérique a été élaboré, et a conduit à créer une cellule d’innovation directement rattachée au DGS. Simultanément, la région a aussi lancé une école de management interne, baptisée Manag’Est. La réactivité de ce vaste territoire, regroupant trois anciennes régions, s’est vue aussi dans la mise en place de 12 maisons de la région. En Île-de-France, pour « débureaucratiser son administration », la région a réorganisé l’ensemble de ses services dans un nouveau siège à Saint-Ouen, avec un Campus des managers et des groupes de travail organisés par métiers.
« Une culture de service au public »
L’une des vertus de la crise sanitaire est d’avoir remis en cause beaucoup de certitudes. « Des hiérarchies et des organisations gravées dans le marbre sont soudain devenues obsolètes », reconnaît ainsi l’étude. Cette crise a surtout permis d’installer « une culture de service au public dans les administrations régionales et achever le passage d’une culture du schéma à une culture du service à l’usager ». Ce bouleversement s’est traduit dans de nombreuses initiatives montrant la transversalité et la réactivité des régions. C’est notamment le cas de la rédaction en urgence, au tout début de la crise sanitaire, d’un Guide du manager en situation exceptionnelle dans le Grand Est. « Le mode projet a pris le pas sur l’organigramme, est-il affirmé. Ces expériences doivent être généralisées et approfondies ». Selon l’Institut Montaigne, elles peuvent même servir d’exemples pour la transformation de l’État.
Concernant les entreprises, l’étude insiste sur le besoin de « surmonter les barrières culturelles qui séparent les acteurs économiques de l'administration régionale ». Il faut ainsi que la région soit réellement au service de ses entreprises, avec une vision à 360 degré des politiques de la région. C’est le cas des initiatives Clubs ETI créés en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France et dans le Grand Est, où se réunissent des entrepreneurs pour travailler en lien étroit avec la région, sur l’ensemble de ses champs de compétence.
Devenir une « région-plateforme »
La région doit devenir une région-plateforme, à la croisée des réseaux du territoire, pour gagner en capacité d’action et en proximité. Les régions fusionnées ont imaginé de nouveaux dispositifs pour développer leur propre réseau, avec la création de « maisons de la région » dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est. Mais leur réussite passe par leur capacité à créer un véritable réseau de partenaires. Le concept de « région plateforme » est devenu très concret au début de la crise sanitaire. La région a joué un rôle de carrefour de l’action collective. Par exemple, en Île-de-France, un groupe WhatsApp a été formé avec les 1200 maires de la région, pour créer une boucle d’échanges directs et informels, largement utilisée tout au long de la crise. La pandémie aura démontré l’importance des réseaux, dans le sens horizontal, par lesquels la mobilisation de tous les acteurs du territoire est possible.
Lycées et transformation numérique
C’est avec la gestion des lycées que les régions sont le plus directement sur le terrain. Même si elles exercent des compétences encore limitées (bâti scolaire, restauration, équipements informatiques), elles le font en accélérant la transformation numérique des établissements. En Île-de-France, la région veut doter chaque lycéen d’un ordinateur ou d’une tablette, en commençant par les lycées professionnels, puis, sur une base volontaire, les lycées généraux. Au total, 180 000 équipements ont été distribués avant la pandémie de 2020. La crise a encore accéléré cette transformation numérique. Souvent tenues à l’écart du système éducatif, les startups entrent au lycée grâce aux régions qui jouent un rôle d’échelon pivot. Avec le déploiement des ressources numériques, c’est avec les équipes pédagogiques elles-mêmes que les régions ont commencé à établir un lien.
La gouvernance de la donnée
Les régions se sont engagées dans le vaste chantier du traitement, du partage et de l'exploitation des données. Elles fédèrent les acteurs et créent la confiance nécessaire au partage de données, notamment la géo-data. « La donnée n’est plus conçue dans une logique statistique mais de contribution », explique l’enquête. Dans les Hauts-de-France, la plateforme Géo2france soutenue par l’État et la région, est « à la fois un outil et une communauté ». La géolocalisation des données en fait le levier d’une transversalité qui bouleverse les frontières des politiques publiques.
Selon l’Institut Montaigne, la région peut constituer un échelon pivot dans la gouvernance de la donnée. C’est le cas par exemple en Île-de-France, avec le concept de « Smart Région ». Avec des partenaires privés, elle engage l’agrégation du plus grand nombre possible de données privées et publiques, au service d’une usine à services numériques. Point fort de cette démarche : la capacité à créer rapidement des services concrets pour les usagers et les partenaires de la région dont les collectivités. Les régions les plus en pointe sur la gouvernance de la donnée sont aussi celles qui commencent à explorer l’intelligence artificielle (IA) appliquée aux politiques publiques. C’est le cas en Occitanie, où une enveloppe de 3 M€ sera dédiée à des services d’intérêt général, telle que la plateforme Parcours emploi personnalisé. L’IA y est ici utilisée pour décomposer et identifier les compétences qui apparaissent dans les offres d’emploi.
Philippe Pottiée-Sperry
👉 Découvrez le dernier ZePros Territorial
👉 Abonnez-vous gratuitement au journal numérique et à sa newsletter