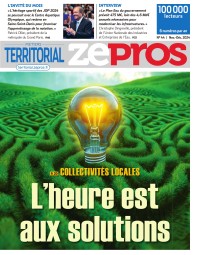Crise de confiance envers l’école : un ressenti très contrasté selon les territoires

Alors que 12 millions d’élèves ont retrouvé le chemin de l’école ce lundi, la dernière étude IFOP pour Les Sherpas (une start-up française engagée pour la réussite scolaire de tous) révèle de fortes disparités dans la manière dont les Français perçoivent le système scolaire. Si la défiance progresse à l’échelle nationale, elle est surtout marquée dans les zones rurales et les villes moyennes, où l’école est jugée moins équitable, moins efficace et moins adaptée aux besoins des élèves. Une fracture territoriale qui interroge, alors que la promesse d’égalité des chances reste au cœur des grands discours éducatifs.
À la question « l’école garantit-elle la même chance de réussir à chaque enfant ? », 58 % des parents franciliens répondent oui (51 % en province, 48 % dans le Nord-Ouest). L’écart se creuse entre villes et campagnes : 54 % d’adhésion dans les communes urbaines de province, mais seulement 43 % en rural. Le sentiment d’un système élitiste est, lui, majoritaire partout — et plus encore dans les grandes aires urbaines : 72 % en Île-de-France, 67 % en province, jusqu’à 73 % dans le Sud-Ouest. « Ces résultats traduisent une réalité bien connue sur le terrain : les zones rurales ne jouent pas à armes égales avec le système des grandes villes — choix d’options, disponibilité des remplaçants, accès au tutorat… », souligne Étienne Porche, co-fondateur des Sherpas.
Sur la transmission des savoirs essentiels, 68 % des Franciliens se disent convaincus, contre 57 % en province (52 % seulement dans le Sud-Est). La perception d’une qualité d’enseignement uniforme chute à 49 % en Île-de-France et à 39 % en province ; elle tombe à 35 % en zones rurales.
Des attentes qui divergent sur les leviers
Ce qui fait réussir ? En Île-de-France, la pédagogie des enseignants arrive en tête (22 %), devant l’encadrement familial et la motivation. Ailleurs, ce sont d’abord les conditions d’enseignement (24 %) — taille des classes, stabilité des équipes, équipements —, puis la motivation (20 %) et la pédagogie (17 %). « La pression scolaire francilienne valorise les qualités individuelles, quand ailleurs on pointe d’abord les manques structurels du système », analyse Étienne Porche.
Pour réduire les inégalités, un consensus se dessine : plus de moyens pour l’Éducation nationale et davantage de formation des enseignants (28 % chacun en IDF ; 29 % et 23 % en province). Les priorités suivantes divergent : autonomie des établissements en région parisienne, réforme des programmes et examens dans le reste du pays.
En bref, la carte de la confiance rejoint celle des ressources disponibles. Là où l’offre éducative est dense et stable, la confiance tient ; ailleurs, elle vacille.