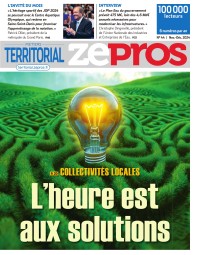Assurabilité des territoires : le risque d’une France à deux vitesses

Selon une étude du Groupe SCET et du cabinet Bureau T pour la Banque des Territoires, la hausse des primes et le retrait des assureurs menacent la couverture de milliers de communes. Face à l’explosion des aléas climatiques, l’accès à l’assurance devient un enjeu d’équité territoriale.
La France découvre un nouveau visage de la vulnérabilité : celui de ses territoires inassurables. Longtemps préservées par des contrats avantageux, les collectivités locales subissent aujourd’hui de plein fouet la fin d’un cycle. Tarifs multipliés par deux à quatre, garanties réduites, refus d’assureurs : selon l’Association des maires de France, près de 1 500 communes seraient déjà concernées.
En cause, une accumulation de crises – climatique, sociale et économique – qui fragilise le modèle même de l’assurance publique. Les sécheresses à répétition, les inondations, les tempêtes et les violences urbaines ont fait exploser la sinistralité, doublant les coûts d’indemnisation d’ici 2050. Certaines zones littorales ou rurales, exposées à la fois aux aléas naturels et à des finances exsangues, cumulent les handicaps.
Derrière les chiffres, c’est tout un équilibre qui se fissure : environ 5 100 communes conjuguent forte exposition au risque et faibles marges budgétaires, compromettant leur capacité à financer la prévention. À terme, c’est l’attractivité économique et démographique de ces territoires qui pourrait s’éroder, faute d’assureurs et d’investisseurs.
Vers une refondation du modèle assurantiel
L’étude publiée en octobre 2025 par le Groupe SCET et Bureau T pour la Banque des Territoires tire la sonnette d’alarme : le marché de l’assurance des collectivités est « déséquilibré, dominé par deux acteurs et sous forte tension concurrentielle ». Si le plan gouvernemental pour l’assurabilité et la cellule CollectivAssur apportent des réponses d’urgence, ils ne règlent pas le problème de fond.
Le rapport préconise une refondation complète du modèle : intégrer la prévention du risque dans la planification urbaine, renforcer les compétences locales en gestion du risque et adapter les régimes d’assurance aux nouveaux aléas. Parmi les pistes évoquées : la création de captives régionales pour mutualiser les risques, la modulation des franchises selon les efforts de prévention, ou encore une couverture publique résiduelle pour les communes les plus exposées.
« L’assurabilité n’est plus seulement une question financière, c’est un enjeu de cohésion nationale », résument les auteurs du rapport. Sans réponse coordonnée, la France pourrait bien voir se dessiner une géographie du risque… à deux vitesses.