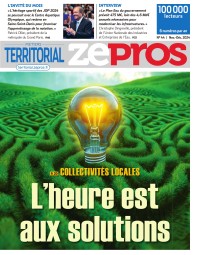Covid-19 : un impact financier très variable selon les collectivités

« Si la situation financière du secteur public local s’est dégradée en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, plusieurs facteurs ont contribué à limiter l’ampleur de cette dégradation ». Telle est l’une des conclusions du rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances locales, publié le 30 juin.
Fin 2020, la situation globale des finances locales se rapprochait de celle de 2018, avec toutefois de fortes différences d’une collectivité à l’autre, liées aux structures respectives de leurs charges et de leurs produits, reconnaissent les magistrats financiers. Ce nouveau rapport sur l’impact financier du Covid-19 sur les collectivités confirme un certain nombre de constats déjà connus.
Une dégradation « moindre qu’anticipé »
Estimant que la dégradation des finances locales a été moindre qu’anticipé, et beaucoup moins importante que pour les comptes de l’État et de la sécurité sociale, la Cour reconnaît néanmoins un « choc » avec pour effet d’interrompre plusieurs années favorables ayant vu l’épargne des collectivités progresser de près de 10 Md€ en cinq ans. Les produits de fonctionnement ont légèrement diminué (-0,8 %) alors que le PIB national se repliait de 8,3%. Les pertes de recettes ont été atténuées par la stabilité des produits de la fiscalité locale, ainsi que par les dispositifs de soutien exceptionnels de l’État. Pour leur part, les charges de fonctionnement ont augmenté de 1,3% en 2020 à périmètre constant. Les économies liées aux achats de biens et services ont été supérieures aux surcoûts engendrés par les acquisitions d’équipements et matériels de protection, mais les dépenses sociales ont augmenté, notamment pour les départements (+3,9%). Un constat différent de celui établi par l’AMF qui continue de pointer 2 Md€ de pertes de recette tarifaires pour le bloc communal en 2020, non compensées par l’Etat.
Baisse de 10% de l’épargne brute des collectivités
Dans ce contexte, l’épargne brute globale des collectivités locales a donc diminué de plus de 10% en 2020 (35 Md€) pour atteindre un niveau proche de celui de 2018 (35,9 Md€). Les dépenses d’investissement se sont contractées de 7,1%, soit une baisse proche de celle observée en 2014, précédente année électorale pour les communes et leurs groupements. La hausse de la dette (+ 5,3 Md€) est comparable à celle observée en quatre ans entre 2015 et 2019 (+ 5,4 Md€), mais elle reste modérée au regard de l’augmentation de 270,6 Md€ de la dette publique. Derrière ce constat général positif, la Cour des comptes reconnaît l’existence d’une diversité de situations entre catégories de collectivités mais aussi au sein de chacune d’elles.
Un impact plus fort pour les grandes communes et intercos
« Les collectivités du bloc communal offrent une situation contrastée », constate la Cour des comptes. A la faveur d’un ralentissement ou d’une suspension de certains services, les dépenses de fonctionnement baissent mois (- 0,3 %) que les recettes (- 1,3 %). Dans ce contexte, l’épargne brute connaît un repli (- 5,5 %), plus marquée pour les communes que pour les EPCI. Une disparité importante apparaît en fonction de la strate démographique. Les communes ou intercos les plus peuplées, assumant des charges de centralité et plus concernés par la baisse sensible de recettes essentielles (recettes d’exploitation et versement mobilité notamment), ont été plus fortement affectés par le contexte économique et sanitaire. Cette situation difficile, associée à une mise en place retardée des nouveaux exécutifs à cause du décalage du second tour des municipales, a freiné la mise en place des nouveaux programmes et l’engagement de nouvelles opérations. « Ainsi, les dépenses d’investissement du bloc communal, qui ont contribué au soutien à l’économie locale, via notamment la participation aux fonds d’urgence régionaux, reculent de 14,8 % », remarque la Cour. Cette réduction de l’investissement est plus accentuée que lors du précédent début de mandat.
Départements : des recettes relativement préservées
La situation des départements s’est dégradée en 2020. L’impact de crise se traduit dans la progression de leurs dépenses sociales (+ 3,9 %), particulièrement celle du RSA (+ 6,7 %). « Elles représentent une part croissante de leurs dépenses de fonctionnement (56,2 %), renforçant leur rigidité », analysent les magistrats financiers. Leurs recettes, bien que dépendantes de la conjoncture économique, ont légèrement augmenté à périmètre constant (+ 0,5 %). La baisse du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) a été limitée (- 1,7 %) et bien moindre que certaines estimations faites courant 2020. Le mécanisme d’avances de DMTO, principale mesure de soutien de l’État en faveur des départements, a été en définitive peu mobilisé. L’épargne globale recule fortement mais demeure malgré tout élevé, permettant ainsi une nouvelle hausse des investissements (+ 1,5 %). Ces derniers ont été financés par une augmentation du recours à l’emprunt (+ 57,2 %, soit + 1,4 Md€). Si leur encours de dette progresse de 3,4 %, conduisant leur ratio de désendettement à se dégrader légèrement pour atteindre 4,1 années, ce dernier reste néanmoins très inférieur au seuil d’alerte de dix ans.
Autre constat : la dégradation de la situation a été plus importante pour les départements de plus d’un million d’habitants, dont les recettes ont diminué alors que leurs dépenses progressaient nettement (+ 4 %). Cette strate a subi les effets de la crise avec à la fois une baisse de leurs produits de DMTO (- 4,6 %) et des dépenses sociales plus élevées (+ 4,9 %)
Régions : un recours à l’emprunt plus que doublé
Dans l’ensemble, les régions ont vu leur situation financière se dégrader en 2020, en rupture avec les années précédentes. La crise sanitaire en est la cause principale, en provoquant une baisse de leurs produits réels de fonctionnement, sans mise en place de mesures de soutien de l’État autre que sur les recettes spécifiques des collectivités de Corse et d’Outre-mer. Cette baisse de recettes de fonctionnement de 2,1 Md€ comprend toutefois 1,7 Md€ de compensation à l’État de la recentralisation de la compétence apprentissage, soit une évolution de - 0,4 Md€ à périmètre constant.
Cette diminution de leurs produits réels de fonctionnement est trois fois plus importante que celle de leurs charges réelles de fonctionnement (- 0,7 Md€, prenant en compte la diminution des dépenses d’apprentissage), entrainant ainsi une chute de leur épargne brute de 22 %. Dans le même temps, leurs dépenses réelles d’investissement, notamment en soutien aux entreprises, ont crû de 15 % (+ 1,7 Md€). Ces dépenses incluent leur participation aux fonds de solidarité : contribution de 500 M€ au fonds national de solidarité et 94 M€ consommés par les fonds régionaux mis en place en partenariat avec la Banque des territoires (215 M€ de prêts accordés aux entreprises).
Conséquence : une forte augmentation du recours à l’emprunt de 2,7 Md€ par rapport à 2019 (de 2 à 4,7 Md€), soit + 131 %, en recourant, notamment, à des émissions obligataires pour un montant de 2 Md€. Après plusieurs années d’amélioration, la capacité de désendettement des régions s’est ainsi dégradée, passant de 4,3 ans à 6 ans. Cette tendance générale traduit cependant de fortes différences de situations, le ratio de désendettement des régions s’étalant de 2,6 ans à 25,8 ans !
Régions de France salue le rapport de la Cour des comptes
A la publication du rapport de la Cour des comptes, l’association Régions de France a immédiatement réagi pour saluer son contenu : « Contrairement aux évaluations parlementaires publiées jusqu’à présent, il démontre que les régions constituent la catégorie de collectivité dont les finances ont été le plus affectées par la crise alors même qu’elles n’ont bénéficié d’aucun mécanisme de soutien financier de la part de l’Etat en 2020 ». Satisfaction également de la reconnaissance par les magistrats financiers des moyens exceptionnels engagés par les régions pour répondre à la crise sanitaire.
L’association rappelle que l’accord de partenariat signé entre les régions et le Premier ministre en septembre dernier a permis de sécuriser en partie leurs ressources pour 2021 en remplaçant la part régionale de CVAE par une fraction de TVA. Dans le même temps, elle reproche à l’Etat d’avoir décalé et étalé sur 2021 et 2022 l’enveloppe de 600 M€ pour soutenir les investissements régionaux en 2020. Estimant avoir respecté leurs engagements prévus par l’accord de partenariat en engageant déjà plus de 12 Md€ sur 2021 et 2022 au titre des accords de relance, les régions « demandent, en contrepartie, que l’Etat tienne ses engagements en débloquant définitivement l’enveloppe de 600 M€ et en adoptant des mesures visant à compenser la forte baisse de recettes dans les transports publics ».
Philippe Pottiée-Sperry