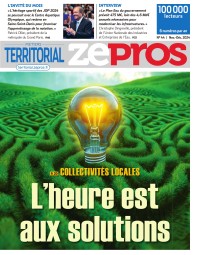Villes moyennes : hausse des investissements et vieillissement des agents

Dans un contexte financier toujours incertain, Villes de France, association représentant les villes moyennes de 10 000 à 100 000 habitants, a réalisé une enquête (1) afin de connaître les principales orientations budgétaires et ressources humaines (RH) anticipées en 2021.
En premier lieu, concernant l’impact de la crise du Covid-19 sur les équilibres budgétaires en 2020, une petite majorité des répondants (26 villes sur 49) le juge « globalement absorbable au niveau des équilibres ». En effet, même si une baisse des recettes de fonctionnement est constatée dans pratiquement toutes les villes en 2020, l’augmentation des dépenses de fonctionnement ne concerne qu’un tiers d'entre elles. Globalement, la baisse des recettes est donc compensée par la diminution des dépenses en 2020, et notamment par une diminution du poste des achats et des prestations de services.
Pas de hausse des taux de foncier bâti et non-bâti
Selon l’enquête, il se dégage plusieurs tendances marquantes pour ce début de mandat. En matière de fiscalité, 92% des villes interrogées vont maintenir, voire baisser, leurs taux de foncier bâti et non-bâti. Cette décision de ne pas aggraver la pression fiscale s’explique par la volonté de « redonner du pouvoir d’achat aux ménages ». Seulement quatre villes sur l’échantillon de 49 vont faire évoluer leurs taux de foncier bâti à la hausse mais très légèrement (+0,5% en moyenne). Au niveau des groupements, la proportion des EPCI augmentant cette année leur fiscalité est plus importante qu’au niveau des villes (dans 20% des réponses). Ces augmentations concernent en particulier la taxe d’enlèvement des ordures ménagères revue à la hausse.
Augmentation des investissements
S'agissant des budgets, les villes moyennes vont continuer en 2021 à maitriser l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Le taux d’évolution prévisionnel des budgets entre 2020 et 2021 s’élève à + 3% en volume global. Il est juste de +0,6 % pour les dépenses de fonctionnement mais atteint +7,6 % pour les dépenses d’investissement. 2021 devrait se traduire dans les villes moyennes par « une augmentation mesurée des budgets et de leurs dépenses globales » (+ 3% en moyenne globale pour les 49 villes répondantes). L’augmentation du volume des budgets devrait être très nettement portée par la reprise de l’investissement du bloc communal, en lien avec la politique de relance et les aides de l’Etat liées à la transition écologique (CRTE), estime Villes de France.
Les secteurs d’investissement restant prioritaires dans les budgets 2021 : l’aménagement urbain du centre-ville en lien avec le programme Action cœur de ville, les travaux de voirie, la préservation du patrimoine, les dépenses d’éducation et les économies d’énergies… Pour les villes indiquant investir davantage en 2021 qu’en 2020, un peu plus de 40% envisagent d’accroître leur encours de dette. À compétences constantes par rapport à 2020, parmi les 49 villes répondantes, les investissements seront en forte hausse (20% des réponses), en hausse (45), stables (20%) et en retrait (14%).
Anticiper le vieillissement des agents
Par ailleurs, la gestion des RH restera un enjeu majeur durant ce mandat, selon l’enquête. Principal constat : une population d’agents relativement âgée notamment dans les catégories d’encadrement (catégorie A) et d’encadrement intermédiaire (catégories B). Un phénomène de vieillissement qui doit être anticipé et pris en compte dans la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et le renouvellement des agents dans les années à venir. De plus, un important travail devra être engagé sur la politique en matière de départs en retraite et de renouvellements de poste.
Par ailleurs, 27% des villes répondantes sont sur le point de mettre en place de nouveaux services communs entre la ville et son EPCI. Ils concernent en majorité l’accueil de la population (via la mise en place d’un guichet unique) et de nombreux services supports (informatique, études, commande publique, juridique).
Charges de centralité élevées
L’enquête indique que le nombre moyen d’équivalent temps plein (ETP) pour une ville type de 35 715 habitants s’élève à 627 agents. La majorité des villes interrogées ont un taux d’administration qui s’échelonne de 15 à 20 agents pour 1000 habitants. Ce taux varie de cinq à 27 agents pour 1000 habitants dans le panel étudié avec des effectifs allant de 2007 ETP (pour une ville de plus de 74 000 habitants) à 128 ETP (pour une ville de 12 600 habitants).
Pour une « ville type » de 35 715 habitants, les effectifs sont en moyenne de 17,5 agents pour 1000 habitants, chiffre l’enquête, ce qui traduit un taux d’administration relativement plus important qu’au niveau national (15 agents pour 1000 habitants sur l’ensemble des communes). L’explication réside dans des charges de centralité plus élevées dans les villes moyennes (activités scolaires et périscolaires, cantines, secteurs culturels, sportifs ou de loisirs…).
Un absentéisme élevé pour les agents C
Conséquence d’effectifs vieillissants et des périodes de confinement, le taux d’absentéisme dans les villes moyennes reste relativement important en 2020, proche de 8%, soit une tendance équivalente à celle de l’ensemble des collectivités. Au sein du panel de l’enquête, le taux d’absentéisme apparaît nettement plus faible dans les catégories d’encadrement (A : 2,3%, B : 4,1%) que dans la catégorie C (8,8%). Pour les agents C, le taux d’absentéisme est très souvent corrélé avec l’âge. « La réalité de la pyramide des âges peut donc poser des difficultés d’organisation évidentes dans certains services, et pour certaines villes, par exemple pour les agents dont l’activité est liée aux écoles et à la petite enfance », constate Villes de France.
Remplacement des départs « au cas par cas »
Après plusieurs années de restrictions importantes, où les remplacements se faisaient a minima (d’un départ en retraite sur deux jusqu’à aucun renouvellement), les villes sont arrivées à un pallier au niveau de la réorganisation de leurs RH. Désormais, elles privilégient essentiellement un remplacement des départs « au cas par cas », tout en favorisant les logiques de redéploiements internes, en adaptant en continu l’organisation des services publics locaux, voire en réinterrogeant la pertinence de certains d’entre eux.
Enfin, le coût annuel des heures supplémentaires est très variable d’une ville à l'autre. Dans l’échantillon, le volume moyen annuel se situe à 13 576 heures, soit environ l’équivalent de 8,4 ETP. Le coût budgétaire annuel moyen est de 265 000 € (amplitude allant de quelques milliers d’euros à 1,4 M€ pour les villes les plus importantes).
P.P.-S.
(1) Échantillon : 49 villes ont répondu à l’enquête (moyenne de la population : 35 715 habitants)
👉 Découvrez le dernier ZePros Territorial
👉 Abonnez-vous gratuitement au journal numérique et à sa newsletter