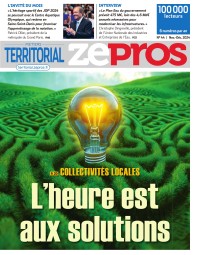3 minutes... 3 questions dans les conditions du direct

Zepros Territorial vous emmène chaque semaine avec « Place des élus », premier réseau social dédié aux élus et aux acteurs locaux, à la rencontre d’un élu de France. Invité cette semaine, Patrick Durand, Président du Syndicat intercommunal à vocation unique SIAEP de Grandpuits-Bailly-Carrois, Fontenailles, Saint-Ouen-en-Brie et Clos-Fontaine (77). Un échange sans détour, à ne pas manquer !
Patrick Durand, président du SIAEP de Grandpuits-Bailly-Carrois, Fontenailles, Saint-Ouen-en-Brie et Clos-Fontaine, détaille la feuille de route eau potable de ce syndicat rural : schéma directeur sur 10 à 30 ans, rénovation du château d’eau, chasse aux fuites avec Veolia et cap sur un rendement de 85–90 %. Le prix de l’eau reste contenu aujourd’hui (autour de 3,50–4 €/m³ tout compris), mais les renouvellements de canalisations pèseront demain. Rencontre.
Vous présidez un syndicat intercommunal de l’eau très rural. Quel est son périmètre et ses compétences ?
Patrick Durand. Le SIAEP regroupe quatre communes autour de Grandpuits-Bailly-Carrois, environ 4 000 habitants au total. Il existe depuis 1962. Nous gérons l’alimentation en eau potable et, particularité rarement transférée, la défense extérieure contre l’incendie (poteaux incendie). Chaque commune dispose de délégués au sein du syndicat.
Quels ont été les chantiers structurants du mandat ?
Nous en avons deux majeurs. D’abord un schéma directeur d’alimentation en eau potable, lancé en 2022. C’est un travail de trois ans qui doit s’achever fin 2025/début 2026. Il nous donnera un état des lieux précis et un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations avec des horizons à 10, 20 et 30 ans. Ensuite, la rénovation du château d’eau commun aux quatre communes : après diagnostic, nous engageons des travaux d’étanchéité et de reprise béton pour repartir sur plusieurs décennies de service.
Comment abordez-vous la sobriété hydrique dans un territoire aux réseaux étendus ?
Notre enjeu n°1, c’est le rendement. En milieu rural, on a beaucoup de mètres de conduites pour peu d’abonnés : détecter une petite fuite “goutte à goutte” est plus difficile qu’une casse franche. Nous travaillons en délégation de service public avec Veolia – notre taille ne permet pas une régie – et menons des campagnes régulières de recherche de fuites. Nous sommes autour de 80 % de rendement (le minimum réglementaire est voisin de 60 %) et visons 85–90 %. Chaque point gagné coûte de plus en plus cher, mais c’est la marge utile face au changement climatique.
Et le financement ? Qui paie quoi entre le syndicat et l’exploitant ?
Notre contrat de DSP (15 ans) intègre une part de renouvellement de canalisations financée par le prix de l’eau. Le schéma directeur fixera le reste à notre charge ; nous le couvrirons par fonds propres, subventions (Agence de l’eau), et, si nécessaire, par des ajustements tarifaires à moyen terme. La rénovation du château d’eau se fait déjà sur ce modèle.
Parlons prix. Vos usagers voient-ils la différence
Le prix total (eau + assainissement + taxes) se situe autour de 3,50 à 4 €/m³, selon ce qu’on inclut. Il a suivi l’inflation ces dernières années (6–7 %), sans susciter de remontées massives. À noter que l’assainissement, compétence communale, pèse de plus en plus avec le coût des stations d’épuration. À court terme, nous n’augmentons pas la part “syndicat” ; à plus long terme, les renouvellements de réseaux et les coûts de production pousseront mécaniquement.
Pourquoi rester en DSP plutôt qu’en régie publique ?
À notre échelle, c’est irréaliste : il faut des équipes techniques 24/7, de l’instrumentation et de l’ingénierie difficiles à internaliser pour 4 000 habitants. La tendance est au regroupement des services à l’échelle intercommunale, mais chaque territoire a ses contraintes (historiques d’endettement, pratiques, etc.). La DSP nous apporte des moyens industriels que nous n’aurions pas seuls.
La trajectoire d’ici 2026 en trois priorités ?
Finaliser le schéma directeur et enclencher les premiers renouvellements de canalisations ; sécuriser le château d’eau pour 30–60 ans ; poursuivre la chasse aux fuites pour tenir la cible 85–90 % de rendement tout en maîtrisant la facture des usagers.