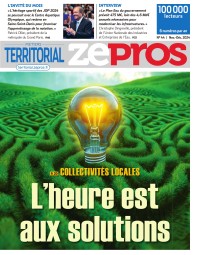3 Minutes / 3 Questions dans les conditions du Direct avec Henri Hasser, maire de Ban-Saint-Martin, vice-président de Metz Métropole et président du Syndicat mixte du SCoT de l'agglomération Messine

Zepros Territorial vous emmène chaque semaine avec France Climat à la rencontre d’un élu de France. Un format direct, rapide et percutant pour découvrir les défis, réussites et visions d’hommes et de femmes engagés. Invité cette semaine, Henri Hasser, maire de Ban-Saint-Martin, vice-président de Metz Métropole et président du Syndicat mixte du SCoT de l'agglomération Messine. En 3 minutes chrono, il partage ses projets marquants, ses petites frustrations et ses grandes ambitions pour sa commune. Un échange sans détour, à ne pas manquer !
Vous avez mené plusieurs projets au cours de votre mandat. De quel projet abouti êtes-vous le plus fier ?
Sans hésitation, je dirais la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). C’était un exercice complexe qui nous a demandé une vision d’ensemble, notamment sur le paysage, un sujet essentiel pour notre territoire. Nous avons un équilibre à trouver entre paysage urbain et paysage naturel, tout en intégrant les grandes transitions écologiques. Ce projet a été un véritable défi, tant sur le fond que sur la méthode, et nous avons parfois eu du mal à trouver des bureaux d’études spécialisés. Mais aujourd’hui, les équipes sont fières du travail accompli et le résultat est à la hauteur de nos attentes.
Y a-t-il un projet abouti qui vous laisse malgré tout un goût d’inachevé ?
Oui, la planification territoriale reste un sujet délicat et inachevé. Nous sommes confrontés à un fatras de textes, parfois contradictoires, et à des injonctions paradoxales : il faut réindustrialiser, mais aussi préserver le foncier agricole, limiter l’artificialisation des sols et répondre aux nouvelles lois environnementales. Tout cela est nécessaire, mais il faut aussi garder en tête la réalité locale. Chaque territoire a une identité propre, une histoire, une culture, et on ne peut pas appliquer des normes uniformes sans prendre en compte ces spécificités. Aujourd’hui, l’aménagement du territoire est un véritable casse-tête administratif, et tant que l’on n’aura pas une approche plus pragmatique et territorialisée, il restera toujours une part d’inachevé.
Quel projet marquera votre mandat ?
Je pense que ce sera le plan paysage. Ce projet est innovant car il ne se limite pas à la seule gestion de l’espace, mais propose une méthodologie de travail basée sur une approche globale. Il touche à de nombreux domaines : sols, eau, patrimoine agricole, forêt, friches industrielles… Nous avons cherché à changer de paradigme en incitant chacun à repenser son rapport à l’environnement et à son territoire. Ce qui est marquant, c’est que cette démarche a été récompensée par un Grand Prix du Paysage, alors même que notre territoire n’a pas les reliefs spectaculaires du Mont-Blanc ou des côtes bretonnes. Cela montre que l’attractivité d’un paysage ne dépend pas uniquement de sa beauté naturelle, mais aussi de la façon dont il est aménagé et respecté.
Vous avez mentionné les friches industrielles comme un enjeu clé. Quel regard portez-vous sur leur réhabilitation ?
C’est un défi majeur, surtout dans une région qui a connu un passé industriel fort, avec la sidérurgie et d’autres industries lourdes. Ces friches constituent aujourd’hui un potentiel immense, mais leur réhabilitation est souvent coûteuse, notamment à cause de la pollution des sols. Pourtant, nous avons aujourd’hui des technologies avancées qui permettent de dépolluer et de reconvertir ces espaces. Le problème, c’est souvent le coût et la fiscalité. Il est parfois plus rentable de créer un nouveau site en périphérie que de réhabiliter une friche existante. Il faudrait donc revoir certains mécanismes fiscaux pour encourager ces projets. Si nous voulons vraiment limiter l’étalement urbain et protéger les terres agricoles, nous devons rendre la réhabilitation des friches plus attractive.
Entre urbanisation et préservation de l’environnement, comment trouvez-vous un équilibre ?
C’est une question cruciale. Aujourd’hui, nous avons d’un côté des pressions pour construire, car il faut loger les populations, développer l’économie, et de l’autre des impératifs écologiques de préservation des sols et des ressources naturelles. Nous devons avancer avec intelligence, et cela passe par une meilleure gestion du foncier existant.
Plutôt que d’étendre les villes, nous devons réinvestir les centres-villes, réhabiliter les logements vacants, densifier intelligemment. Mais cela demande du temps, des moyens et un accompagnement juridique adapté. La vacance immobilière est un problème, et ce n’est pas toujours un manque de volonté des communes. Dans certains cas, des immeubles restent inoccupés pendant des années à cause de problèmes de succession ou de complexités administratives.
Quel rôle jouent les collectivités locales dans cette transformation ?
Les collectivités sont en première ligne, mais elles manquent parfois de marges de manœuvre. Les grandes orientations viennent de l’État, mais leur application sur le terrain est souvent complexe. Prenons l’exemple du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) : l’objectif est louable, mais il faut aussi donner des outils concrets aux territoires pour l’atteindre.
Nous devons aussi mieux articuler les échelles de décision. Les intercommunalités, les métropoles et les régions doivent mieux collaborer pour éviter des décisions incohérentes entre territoires voisins. Il faut une vraie approche partenariale, où l’État accompagne plutôt qu’il n’impose.
Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez au quotidien ?
La complexité administrative et la lourdeur réglementaire sont un frein majeur. Nous devons sans cesse jongler entre différentes lois, réglementations, et cela peut ralentir considérablement les projets.
L’autre difficulté, c’est la gestion des conflits d’usage. Quand on veut construire un nouvel équipement, il y a toujours des oppositions : certains craignent des nuisances, d’autres veulent préserver un espace naturel, d’autres encore pensent que ce n’est pas la priorité. Notre rôle est donc d’être des médiateurs, d’expliquer, de trouver des compromis et d’assurer un développement équilibré.
Quelle vision souhaitez-vous porter pour l’avenir des territoires ?
Je pense que l’avenir doit reposer sur une approche pragmatique et durable. Nous devons réconcilier économie et écologie, valoriser les territoires plutôt que de les uniformiser, et surtout garder une vision à long terme.
L’attractivité d’un territoire ne se mesure pas seulement à son dynamisme économique, mais aussi à sa qualité de vie, à la préservation de son identité et à sa capacité à innover. Nous avons aujourd’hui des défis immenses, mais aussi des opportunités formidables. Si nous parvenons à mobiliser les énergies locales, à associer tous les acteurs – élus, citoyens, entreprises –, alors nous pourrons construire des territoires plus résilients et plus attractifs.