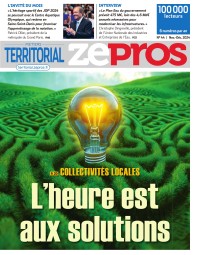Accès aux soins en montagne : « la co-construction entre les élus et les professionnels de santé est essentielle »

Déserts médicaux, maisons de santé vides, hôpitaux menacés : en montagne, les difficultés d’accès aux soins prennent une acuité particulière. Jean-Pierre Vigier, président de l’Association des petites villes de montagne et député de Haute-Loire, plaide pour une approche territorialisée. Il répond aux questions de Zepros Territorial.
Vous alertez sur les difficultés d’accès aux soins en montagne. En quoi la situation est-elle différente d’ailleurs ?
La spécificité des territoires de montagne, c’est l’éloignement, la lenteur des déplacements, l’enneigement, les routes sinueuses, les bouchons liés au tourisme… Tout cela allonge considérablement les délais pour accéder à un soin. L’organisation des soins ne peut donc pas être calquée sur celle des zones de plaine. Elle doit s’adapter à chaque bassin de vie, avec une logique de proximité renforcée.
Quelle est, selon vous, la clé pour améliorer l’offre de soins en montagne ?
Le cœur du sujet, c’est le maillage territorial. Pas de médecins isolés en montagne : ils ne tiennent pas. Il faut des structures collectives comme les maisons de santé, avec un secrétariat, des outils mutualisés, et une organisation qui permet la continuité des soins quand un praticien part en congé. Et tout cela ne doit pas se faire en silo : la co-construction entre les élus et les professionnels de santé est essentielle. Sinon, on se retrouve avec des bâtiments vides.
Vous plaidez aussi pour une “identité montagne” des maisons de santé ?
Oui, il faut des maisons de santé pensées spécifiquement pour les besoins de la montagne. Par exemple, dans les stations de ski, il faut pouvoir faire face aux urgences liées aux accidents. Il y a une demande de soins spécifiques, une fréquentation saisonnière… Il faut donc adapter les équipements et les effectifs en conséquence.
Quelles solutions pour maintenir ou renforcer les hôpitaux de proximité ?
On doit tout faire pour garder les hôpitaux ruraux et de montagne. À condition qu’ils soient correctement équipés, notamment avec un scanner, une IRM, de la radiologie numérique. Cela les rend attractifs pour les spécialistes. Dans mon territoire, on a mutualisé certains services avec des CHU. On peut y faire de la chirurgie ambulatoire, ce qui désengorge les urgences et les gros établissements.
La loi Montagne de 2016 prévoyait des mesures spécifiques. Pourquoi si peu d’effets concrets ?
Parce qu’elle n’est pas appliquée ! Beaucoup de décrets d’application ne sont jamais sortis. Voter une loi, c’est bien, mais encore faut-il aller jusqu’au bout. Sinon, elle reste lettre morte. C’est un problème classique dans l’administration centrale : on vote, puis on oublie.
Êtes-vous favorable à une obligation d’installation pour les jeunes médecins ?
Non. Forcer quelqu’un à venir, c’est contre-productif. Il fera le strict minimum. Alors qu’un médecin qui choisit de s’installer s’implique dans la vie locale. En revanche, il faut multiplier les stages en montagne. Si sur dix internes, un seul décide de rester, c’est déjà une victoire.
Quel rôle pourrait jouer un référent montagne au sein des ARS ?
Ce serait très utile. Les ARS sont souvent trop éloignées du terrain. Un référent connaissant la montagne, capable de faire remonter les réalités locales, de faire preuve de bon sens, permettrait de décloisonner et de prendre des décisions plus adaptées. Il faudrait aussi renforcer les pouvoirs des délégués départementaux de l’ARS, bien plus connectés aux réalités.
Et plus largement, que faudrait-il changer dans la gouvernance de la santé ?
Il faut ouvrir le numerus clausus, augmenter les capacités dans les universités, renforcer les maisons de santé, alléger les tâches administratives… Et surtout, construire ensemble, élus et professionnels de santé. Il n’y a pas une solution miracle, mais une somme d’actions complémentaires.
Vous évoquez aussi des dispositifs de salariat pour certains médecins ?
Oui, dans ma région, on a mis en place un GIP (groupement d’intérêt public) qui permet de salarier des médecins. Ils peuvent venir une semaine par mois sur un territoire isolé, avec un vrai contrat. C’est une solution parmi d’autres. Il faut savoir adapter les outils aux besoins spécifiques de chaque territoire.