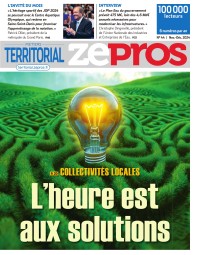L’eau est un bien commun : nous devons apprendre à la protéger et à la partager

Depuis un an, la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole mène une initiative inédite : les « Ambassadeurs de l’eau », chargés d’aller directement dans les foyers pour diagnostiquer les consommations, installer des équipements hydroéconomes et sensibiliser les habitants. Un dispositif salué par les communes et les usagers, qui s’inscrit dans une stratégie plus large de préservation d’une ressource de plus en plus fragile. Sylvie Cassou-Schotte, présidente de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, revient sur les premiers résultats et sur les enjeux structurels auxquels la métropole fait face.
Comment fonctionne concrètement ce dispositif de proximité ?
Nous avons recruté quatre ambassadeurs qui se rendent directement chez les ménages, uniquement après avoir prévenu les familles par courrier. Ils sont identifiables, formés et équipés : gilet, carte, documentation, matériel hydroéconome. L’expérimentation a débuté à Bègles et Talence, puis a été étendue au Bouscat et à une résidence HLM de Cenon avec le bailleur Gironde Habitat. La demande des communes est désormais très forte : Mérignac, Bordeaux, mais aussi d’autres territoires souhaitent s’engager.
À ce jour, environ 1 000 foyers ont bénéficié du dispositif, dont plus de la moitié ont accepté d’ouvrir leur porte. Les retours sont excellents. Les usagers sont très demandeurs d’informations sur l’origine de l’eau, sa qualité, les économies possibles. Cela confirme qu’il existe une véritable attente de pédagogie.
Avez-vous déjà des indications sur l’efficacité du dispositif ?
Il est encore un peu tôt pour mesurer l’impact réel sur les consommations, car l’expérimentation doit durer au moins 18 mois. Mais l’accueil est très favorable et l’enquête de satisfaction montre que les habitants apprécient énormément ce contact direct. Les ambassadeurs ont aussi un rôle de vigilance : lorsqu’une facture d’eau augmente anormalement, notre service relations usagers contacte systématiquement le foyer pour vérifier qu’il n’y ait pas de fuite. C’est complémentaire et très utile. Enfin, les ambassadeurs interviennent aussi lors d’événements publics, en triporteur, ce qui renforce la visibilité du programme.
Quels sont aujourd’hui les principaux défis liés à la ressource en eau dans la métropole ?
D’abord, la quantité. Nous dépendons de nappes profondes très anciennes – une eau dite “de Cro-Magnon”, âgée de plusieurs milliers d’années. Leur régénération est lente et nous devons réduire notre dépendance. Nous travaillons donc à des projets de ressources de substitution notamment un champ captant dans le Médoc. Ensuite, il y a la qualité. Sur ce point, la métropole est très vigilante. Même si l’eau est l’aliment le plus contrôlé de France, nous devons rester attentifs aux risques de pollution. Nous expliquons beaucoup ces enjeux lors des visites, car les habitants ne savent pas toujours d’où vient l’eau qu’ils consomment.
Vous évoquez également la question de la réutilisation des eaux usées. Où en êtes-vous ?
La réutilisation est une piste, mais elle doit être cohérente avec nos objectifs climatiques. Traiter des eaux usées pour certains usages – nettoyage, arrosage, industrie – nécessite beaucoup d’énergie. Nous ne devons pas créer une solution qui génère plus d’impact qu’elle n’en évite. Cela dit, nous avançons. Une directive du Plan Eau a récemment levé certains blocages réglementaires. Nous avons aussi une station d’épuration capable de fournir de l’eau traitée pour le bassin industriel du Bec-d’Ambès, et des expérimentations sur la récupération des eaux pluviales, comme à Mérignac Beau-Désert, ont même été récompensées par un prix de l’innovation.
La lutte contre les fuites est également un axe majeur. Pourquoi ?
Parce que c’est un enjeu colossal. Nous avons 3 200 km de réseau, dont une bonne partie très ancienne – certains tronçons atteignent 70 ans. Avec le dérèglement climatique, les sols se contractent, se dilatent, et les canalisations souffrent davantage. Nous avons donc lancé un plan offensif : réduction drastique des délais de réparation (de huit jours à un jour et demi), robot d’inspection pour le préventif, triplement du rythme de renouvellement des conduites. Ce sont des investissements lourds, mais indispensables.
Face à ces investissements importants, la facture d’eau risque-t-elle d’augmenter ?
Il faut être clair : l’eau a un coût, et les directives européennes vont nous demander des efforts, notamment pour moderniser les stations d’épuration. Nous avons élaboré un schéma d’investissement jusqu’en 2050 pour planifier les travaux, lisser les dépenses et éviter un “choc” tarifaire.
Notre objectif est une évolution progressive et soutenable des tarifs. Par ailleurs, nous avons mis en place une tarification sociale avec un “chèque eau” automatique pour les ménages concernés.
Ce qui manque encore, en revanche, c’est une redevance dédiée aux eaux pluviales : aujourd’hui, seules les collectivités financent cet exorbitant poste d’entretien, alors que les épisodes de pluies intenses se multiplient.
Un dernier mot ?
L’eau est un bien commun, précieux, et qui le sera encore davantage demain. Notre responsabilité est de la protéger, de la préserver, de la partager. C’est le sens de la gestion publique de la Régie et de tous les dispositifs que nous mettons en place. Et dès janvier 2026, avec l'intégration de la régie au service public de l’assainissement collectif aujourd’hui exploité par la Sabom, nous aurons une vision encore plus complète de l’ensemble du cycle de l’eau.