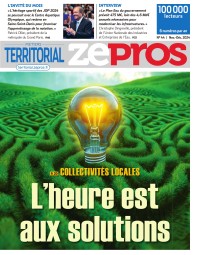Adapter les villes et les décarboner : deux impératifs indissociables

Carine Dunogier est directrice de l’activité Ville chez Ingérop, groupe d’ingénierie pluridisciplinaire engagé dans la transformation durable des territoires. À travers son maillage territorial et son approche globale, elle accompagne les collectivités dans leurs projets urbains, entre adaptation climatique, transition énergétique, mobilités, réemploi et renaturation. Rencontre.
Vous travaillez avec de nombreuses collectivités, de toutes tailles. Comment percevez-vous leur manière d’appréhender la transformation urbaine face aux défis climatiques ?
Nous assistons à une véritable évolution dans les attentes des collectivités. Leurs questionnements sont de plus en plus complexes et pluridimensionnels. Autrefois, elles nous sollicitaient sur des enjeux techniques isolés comme la gestion des eaux pluviales. Aujourd’hui, la commande publique intègre des problématiques croisées : lutte contre les îlots de chaleur, renaturation, réemploi, mobilités douces, sobriété foncière et énergétique… Le changement climatique, la contrainte budgétaire et la pression réglementaire accélèrent cette mutation. Ce qui revient très souvent, c’est : comment faire le bon choix d’investissement dans un contexte de contraintes fortes ? Il ne s’agit plus de juxtaposer des réponses, mais de construire des projets multifonctionnels.
Cette complexité, est-ce un frein ou un levier ?
Un peu des deux. C’est exigeant pour les élus, car ils doivent concilier urgence, sobriété et efficacité. Mais c’est aussi un levier d’innovation. Aujourd’hui, les meilleures solutions sont celles qui articulent plusieurs objectifs : combiner une gestion alternative des eaux pluviales avec de la végétalisation, créer un îlot de fraîcheur tout en intégrant un usage social, ou encore revoir les mobilités en s’appuyant sur des usages existants. Cela suppose une concertation renforcée, une nouvelle culture du projet, et une ingénierie mieux mutualisée entre les services.
Comment travaillez-vous avec les collectivités sur ces enjeux ?
Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur : depuis les diagnostics et les études de faisabilité jusqu’à la mise en œuvre, le suivi et même l’exploitation. L’objectif est d’assurer une transformation durable, mesurable et appropriable. Nous accompagnons aussi bien des métropoles que des villes moyennes ou des communes plus modestes. À Cubzac-les-Ponts (33), par exemple, nous avons élaboré le schéma directeur cyclable. À Clermont-Ferrand (63), nous intervenons sur des projets de requalification urbaine. Notre maillage territorial (plus de 40 implantations en France) est essentiel pour rester au plus près des réalités locales.
Vous parlez souvent « d’adaptation et de décarbonation ». Que recouvrent concrètement ces deux notions dans vos projets ?
Ce sont deux objectifs que nous devons viser en permanence, sans les opposer. L’adaptation, c’est rendre la ville résiliente : lutter contre les îlots de chaleur, repenser la gestion de l’eau, intégrer des solutions de rafraîchissement naturelles, anticiper les événements extrêmes. La décarbonation, c’est réduire les émissions liées à l’aménagement et au fonctionnement des espaces publics : via le réemploi de matériaux, l’optimisation des mobilités, la réduction de l’imperméabilisation ou l’introduction de matériaux moins carbonés.
Comment accompagner les élus face à cette complexité croissante ?
Notre rôle, c’est d’apporter des éléments objectifs, mesurables, pour éclairer la décision publique. Cela suppose de construire des scénarios réalistes, de modéliser les impacts et d’évaluer les arbitrages. C’est aussi un travail pédagogique : montrer que certaines solutions – comme la mutualisation des usages ou la renaturation – peuvent être sobres, efficaces et génératrices de lien social. Nous investissons beaucoup dans l’innovation (IA, modélisation thermique urbaine, indicateurs d’impact…), mais surtout dans l’intelligence collective.
Selon vous, les projets les plus réussis sont ceux qui concilient plusieurs enjeux ?
Absolument. Un bon projet aujourd’hui, c’est un projet qui répond à la fois à une contrainte environnementale, un besoin d’usage local, un impératif de sobriété, et qui est coconstruit avec les habitants. À Lyon Part-Dieu (69), à Nice, avec le projet du Paillon (06), à Notre-Dame de Paris (75) ou à Rennes et le projet de découverte de la Vilaine (35), nous menons des projets ambitieux de renaturation, de transformation de l’espace public, de reconquête de friches, tout en préservant la mémoire des lieux et en intégrant les usages. À l’échelle locale, c’est cette capacité à fabriquer des « solutions hybrides » qui fait la différence.