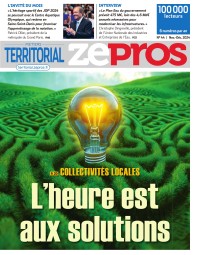« Place au bon sens pour faire avancer les projets locaux avec les acteurs locaux sans attendre la validation d’une administration parisienne »

Finances locales, sécurité, aménagement du territoire, simplification, décentralisation… l’ancien maire de Dijon, répond aux questions de Zepros sans détours. Rencontre.
Zepros Territorial : Ponction sur les recettes fiscales, hausse des cotisations des employeurs territoriaux, gel de la fraction de TVA à son niveau 2024… L’AMF tire la sonnette d’alarme et a déclaré : « Il est grand temps que l’Exécutif tire les conclusions des échecs du passé, en regardant objectivement la situation des comptes publics ». Que répondez-vous ?
François Rebsamen : Le Premier ministre l’a redit lors de sa déclaration de politique générale, l’apport des collectivités territoriales à la croissance et à la cohésion de notre pays est primordial. C’est en reconnaissance de ce rôle singulier que leur effort a été ramené de 5 Md€ à 2,2 Mds€ dans le cadre de la loi de finances 2025. Ce chiffre découle très directement des mesures que le Sénat a adoptées. Parmi celles-ci, le dispositif de lissage conjoncturel de 1 Md€ m’apparaît particulièrement adapté car il répond à l’enjeu de justice sociale et territoriale qui nous oblige, en particulier pour préserver les départements les plus fragiles.
Cette diminution sur les recettes se conjugue avec la hausse du taux de contribution employeur à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRCL), qui pèse pour 1 Md€. Je précise par ailleurs s’agissant des Agences de l’eau que les 130 M€ évoqués sont ponctionnés sur leur trésorerie de sorte que l’impact vers les territoires soit nul. En tant que ministre en charge de l’aménagement du territoire, j’attache une importance particulière à ce que nous nous donnions les moyens d’une véritable péréquation. La hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 150 M€ permettra d’alimenter en partie la hausse de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) dès cette année. En tant que ministre en charge de la décentralisation, je suis un défenseur de l’autonomie financière des collectivités. La hausse temporaire du plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) avec exonération des primo-accédants est une bonne mesure pour donner du « souffle » à nos départements, comme l’est aussi la création d’un versement mobilité pour les régions. Les dotations sont quant à elles préservées à un niveau de 3 milliards d’euros, supérieur au niveau pré-COVID.
Afin de redonner davantage de visibilité, j’organiserai en avril une conférence financière des territoires pour partager un diagnostic des finances locales, accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des objectifs de maîtrise de la dépense publique pour 2025 et définir ensemble les orientations pour 2026.
Z.T. : Les sénateurs ont adopté, en commission, la proposition de loi visant à assouplir une nouvelle fois la mise en place du « Zéro artificialisation nette des sols » qui suscite tant d’inquiétudes chez les élus locaux. Plaidant pour « plus de réalisme » les sénateurs souhaitent remplacer le ZAN par un autre sigle : la « Trace », qui constituerait une « trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux » et permettrait un rythme davantage « compatible » avec les contraintes locales. Vous vous êtes opposé à la suppression totale d’un « point d’étape » ; Pourquoi cette opposition ?
F.R. : Je voudrais, tout d’abord, rappeler que la sobriété foncière constitue un enjeu fondamental de préservation de notre souveraineté agricole, de notre biodiversité et du renforcement de notre résilience face aux effets du changement climatique. Les bouleversements nombreux auxquels notre monde est confronté nous en rappellent chaque jour l’acuité. C’est la raison pour laquelle je suis attaché à ce que nous maintenions l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Toutefois, je dois bien reconnaître que cet objectif de ZAN en 2050 s’est traduit, en droit, par un dispositif complexe qu’il est nécessaire d’assouplir afin de permettre l’émergence de projets locaux, par exemple dans le domaine industriel. Il y a donc une double nécessité de maintenir l’objectif de long terme tout en permettant au ZAN d’être vecteur d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire. S’agissant du « jalon intermédiaire », que vous appelez point d’étape, je suis effectivement opposé à sa suppression et ai proposé qu’il soit décalé de 2021-2031 à 2024-2034. En effet, il permet aux collectivités de bâtir une stratégie de réduction progressive de leur artificialisation jusqu’en 2050. Ce jalon est donc une garantie, et non une contrainte, et je souligne que le décalage que je propose permettra de détendre la trajectoire nationale de réduction de l’artificialisation d’environ 37 500 hectares qui bénéficieront donc aux collectivités.
Cette position traduit ce que je vous disais : le maintien de l’objectif mais l’assouplissement des conditions de sa mise en œuvre.
Z.T. : Le nouveau président de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, Stéphane Delautrette, plaide pour un nouvel acte de décentralisation, jugeant que « La loi « 3DS n’a pas permis grand-chose. Ce qui n'empêchera pas l’Etat de continuer à jouer son rôle régalien et de vigilance ». Souhaitez-vous une grande réforme sur les compétences locales ?
F.R. : En tant qu’élu local, je retiens que le mot décentralisation apparaît dans le nom même du ministère dont j’ai la charge. C’est un principe posé à l’article 1er de notre Constitution mais c’est avant tout un processus. Ce processus, il peut se déployer par à-coups, les fameux « actes », mais c’est aussi une pratique quotidienne : la décentralisation, c’est un synonyme de confiance. C’est redonner du pouvoir d’agir aux élus de terrain, supprimer les contrôles a priori, se garder des transferts en trompe l’œil et les jeux de bonneteau de transferts de charge. Beaucoup de propositions ont déjà été faites et ont déjà été débattues. Avec Stéphane Delautrette, nous partageons une longue expérience et nous nous méfions de la quête du « grand soir ». Dans le contexte parlementaire actuel, il est difficile de dégager des consensus. Alors la première des démarches c’est de faire en sorte que les propositions et projets de loi actuellement débattus, ou inscrits à l’ordre du jour du Parlement, prennent bien en compte la logique de décentralisation. Sans attendre un chamboule-tout institutionnel, qui nécessitera une concertation d’ampleur, on peut déjà différencier, adapter, expérimenter. Je soutiens notamment la démarche visant à renforcer la déconcentration : le partenariat entre les collectivités et l’Etat ne se décrète pas depuis Paris, il s’incarne d’abord dans nos préfectures et sous-préfectures. Car le manque de confiance a priori que les maires ont pu ressentir de la part de l’Etat, les préfets le ressentent parfois de la part de l’administration centrale. Place au bon sens pour faire avancer les projets locaux avec les acteurs locaux sans attendre la validation d’une administration parisienne.
Z.T. : Où en est-on de la mission sur la simplification, tant demandée par les élus locaux, confiée à Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières ?
F.R. : Le premier rapport remis par Boris RAVIGNON a créé un débat intéressant sur l’enchevêtrement des normes et sur l’opportunité économique et financière de simplifier l’action publique locale. Plusieurs milliards d’euros pourraient être économisés par des actions de clarification du droit et des normes opposables aux collectivités, et quelquefois, il faut le dire pour rester fidèle aux conclusions du rapport, certaines normes créées par les collectivités elles-mêmes. C’est notamment le cas en matière d’urbanisme et d’aménagement. Au-delà du constat, il s’agit d’agir. C’est pourquoi j’ai demandé à Boris Ravignon de me formuler dans les prochaines semaines une dizaine de propositions très opérationnelles visant à simplifier et à faciliter l’action des collectivités. Avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous avons également souhaité un travail rapide sur la refonte du cadre global de financement des collectivités, avec des conclusions attendues avant l’été. Dans un troisième temps, d’ici la fin de cette année, nous aurons reçu, par la mission conduite par Boris Ravignon, des préconisations, là aussi opérationnelles, visant à clarifier l’organisation décentralisée de notre Etat. Ces propositions seront traduites en textes réglementaires et législatifs dès que nous serons prêts, après un temps nécessaire de concertation de nos partenaires. Ma méthode sera de travailler étroitement avec le Sénat et l’Assemblée nationale, en accompagnant toutes les initiatives parlementaires qui viseront à simplifier notre action publique locale et donc à la rendre plus compréhensible et plus lisible par les Français. L’enjeu de la simplification de l’action publique est profondément politique : si nous parvenons à apporter plus rapidement des réponses aux usagers, qu’ils soient une famille ou une entreprise, si nous arrivons à ne plus les promener d’un guichet à l’autre et à mieux répondre au « qui fait quoi », si nous redonnons de la capacité d’agir à nos élus locaux au plus proche des réalités locales, alors nous aurons contribué à réinjecter de la confiance dans nos institutions et à raffermir les fondations de notre vie démocratique.
Z.T. : À la question « Quels sont les enjeux déterminants de votre vote aux prochaines élections locales ? », dans le cadre de l’enquête réalisée par l’IFOP pour le compte d’Intercommunalités de France à l’occasion de sa 34e Convention nationale, les Français interrogés placent « les dispositifs locaux de prévention de la délinquance » en haut de la liste des compétences du bloc local. Or, une minorité d’intercommunalités disposent aujourd’hui d’une police municipale intercommunale (10 % du panel des collectivités interrogées dans le cadre de l’enquête réalisée par Intercommunalités de France et France urbaine, en décembre 2023). Quels dispositifs pour répondre aux attentes des élus et des populations ?
F.R. : Tout d’abord, permettez-moi de rappeler mon attachement à ce que l’Etat et les collectivités travaillent main dans la main pour l’intérêt général. Ayant été maire de Dijon pendant plus de 20 ans, j’ai acquis la conviction profonde que les élus locaux comprennent mieux que quiconque à Paris, les besoins spécifiques de leurs territoires. Une conviction que partagent les Français qui sont d’ores et déjà près de 65% à s’intéresser aux élections municipales de 2026 (selon une étude récente Verian pour Le Figaro). Dans le contexte actuel que vous décrivez de hausse de l’insécurité je pense que les collectivités doivent être en mesure d’adapter leur arsenal sécuritaire aux situations auxquelles elles sont confrontées. Le Beauvau des polices municipales va dans ce sens puisqu’il vise à donner plus de latitude aux maires quant à la détermination des prérogatives de leur police. Les concertations avec les élus et les policiers sont actuellement en cours, je vous invite à interroger le ministre François-Noël Buffet, qui présentera son texte de loi au Parlement avant l’été.
Z.T. : Dans le contexte géopolitique et économique inquiétant, quel message souhaiteriez-vous adresser aux maires de France et à ceux qui hésitent à s’engager pour les prochaines municipales ?
F.R. : Je veux leur dire d’abord que j’ai été Maire de Dijon pendant 24 ans, et que pour moi c’est le plus beau des mandats. C’est un mandat de proximité, qui permet à la fois d’agir dans le présent pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et de préparer leur avenir et celui de leurs enfants. Les citoyens ne s’y trompent pas car dans la défiance qui frappe la classe politique, ils sont les seuls à conserver leur confiance. Je connais bien les difficultés auxquelles sont confrontés les maires et qui peuvent faire hésiter à s’engager. Toute l’action de mon ministère est axée sur la volonté de résoudre ces difficultés. La réforme du statut de l’élu, des mesures de simplification, des solutions pour l’assurabilité des communes, vont dans ce sens. Mais quelque soient les difficultés, je leur dis n’hésitez pas, engagez-vous, les Maires sont aujourd’hui les « hussards de la République » ceux qui sauvegardent le vivre ensemble, indispensable à l’apaisement dont notre pays a tant besoin.