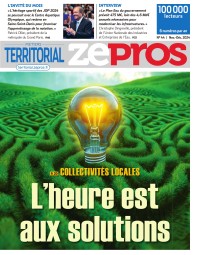Réformes de la fiscalité locale : déshabiller Pierre pour habiller Paul

Suppression de la taxe d’habitation, allègement de la fiscalité des entreprises, dégrèvement des locaux industriels… depuis 2018, l'État a profondément remanié la fiscalité locale, réduisant de 38 milliards d’euros la facture des ménages et des entreprises en 2023. " Mais derrière cette réforme pensée pour le pouvoir d’achat et la compétitivité, les collectivités territoriales naviguent entre perte de ressources et nouveaux équilibres budgétaires" avertit la Cour des Comptes.
À première vue, les réformes de la fiscalité locale sont une bonne nouvelle pour les ménages et les entreprises. Selon un rapport de la Cour des comptes publié le 15 janvier 2025, leur contribution a baissé de 38 milliards d’euros en 2023 par rapport à un scénario sans réforme. Même en intégrant la hausse d’autres impôts locaux (comme les droits de mutation), le gain net pour les contribuables reste de 16 milliards d’euros entre 2017 et 2023, d'après les calculs des Sages des le rue de Cambon.
Une facture allégée pour les contribuables, un poids pour l’État
Mais cette réforme n’a pas été pensée pour équilibrer les finances locales. Son objectif principal ? Soutenir le pouvoir d’achat des ménages et renforcer la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. L’État a donc dû compenser la perte de recettes pour les collectivités. Résultat : une ponction de 38,5 milliards d’euros sur ses propres finances, soit 25 % du déficit public de 2023. Si les communes, départements et régions ont été compensés financièrement, la réforme a modifié la nature de leurs ressources. Avant, elles reposaient largement sur des impôts locaux bien identifiés (taxe d’habitation, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impôts fonciers). Désormais, une partie importante de leurs recettes vient de transferts de l’État (TVA, dotations).
" Et ce changement a des conséquences" avertissent les expert. D'abord une rupture du lien fiscal avec les habitants : certains ménages ne paient plus directement d’impôts locaux, ce qui peut brouiller leur perception des services publics financés par leur commune. Mais aussi moins d’incitation à construire : sans rentrées fiscales directes sur les logements créés, certaines communes pourraient être tentées de freiner l’urbanisation. Enfin, un frein à l’accueil d’entreprises : de la même manière, sans gains fiscaux directs, les collectivités pourraient être moins enclines à attirer de nouvelles activités économiques.
Des collectivités encore aux commandes, mais avec des limites
Malgré ces évolutions, les communes et intercommunalités conservent encore un pouvoir fiscal réel, contrairement aux régions et départements, dont les marges de manœuvre sont plus limitées. Toutefois, la Cour des comptes pointe plusieurs écueils persistants :
- Une fiscalité foncière toujours inadaptée aux réalités économiques, qui ne reflète pas toujours la pression fiscale locale.
- Des compensations financières figées sur des bases historiques, qui risquent de creuser les inégalités entre collectivités.
Alors, faut-il revoir encore la fiscalité locale ? Si l’État veut éviter d’aggraver son propre déficit tout en garantissant aux collectivités une autonomie financière réelle, la question risque de revenir rapidement sur la table.