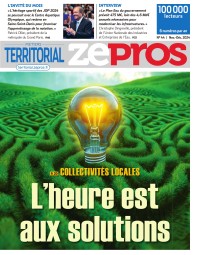« L’innovation publique doit devenir un réflexe au sein des organisations »

À l’occasion des premières Assises de l’innovation publique organisées par le CNFPT, Benoît Vallauri, directeur des partenariats, des territoires et de l'innovation, revient sur les enseignements de cette édition fondatrice. Entre maturité des pratiques, reconnaissance encore parcellaire et besoin de formation des agents, il plaide pour une innovation utile, ancrée dans le réel et structurée autour de métiers reconnus.
Les Assises de l’innovation publique ont réuni de nombreux participants. Quel bilan tirez-vous de cette première édition ?
`Le bilan est très positif. Ces Assises ont véritablement fait le plein, ce qui montre que le sujet de l’innovation publique trouve aujourd’hui un écho fort dans les collectivités et les organismes partenaires. Nous avons proposé une programmation fondée sur les résultats d’une enquête menée cet été, pour coller au plus près des préoccupations des innovateurs et innovatrices publics. Nous avons aussi veillé à faire dialoguer praticiens et experts, en associant retours d’expérience, apports théoriques et perspectives de recherche. Ce croisement de regards a été très apprécié : il a permis aux agents d’interroger leurs pratiques, de les nourrir, et parfois de leur redonner du sens.
Que recouvre aujourd’hui la notion d’innovation publique ?
Elle recouvre plusieurs typologies complémentaires. Il y a d’abord l’innovation de gouvernance, qui concerne les nouvelles méthodes de gestion et de décision. Ensuite, l’innovation technologique, souvent la plus visible, mais qui n’est qu’une composante de l’ensemble. Les défis actuels consistent à concilier le développement des services numériques avec l’égalité d’accès, par exemple pour les publics éloignés du numérique. Demain, l’enjeu sera aussi de savoir comment intégrer l’intelligence artificielle dans les organisations publiques sans sacrifier ni l’éthique ni la qualité du service rendu. L’innovation publique, c’est aussi l’innovation réglementaire (adapter les cadres juridiques), l’innovation sociale, organisationnelle ou encore des métiers : tous ces champs interagissent pour faire évoluer la culture du service public.
Vous évoquez l’innovation des métiers : pourquoi est-ce un axe stratégique pour le CNFPT ?
Parce qu’elle traduit la transformation concrète des administrations. De nouveaux métiers émergent, comme les facilitateurs de coopération, les chefs de projet innovation territoriale ou encore les designers publics. Pour ces profils, il faut définir des socles de compétences et bâtir des parcours de formation adaptés. C’est une condition essentielle pour professionnaliser l’innovation et renforcer son attractivité.
Nous avons identifié trois priorités : diffuser une culture de l’innovation à tous les agents, professionnaliser ceux qui en font déjà sans en avoir la reconnaissance statutaire, et enfin former les décideurs publics aux théories de l’innovation afin qu’ils comprennent les logiques à l’œuvre, au-delà des simples outils.
L’innovation part-elle réellement du terrain, comme on l’entend souvent ?
Oui, dans la grande majorité des cas. L’innovation publique naît de la confrontation directe avec les problèmes du quotidien, au plus près des usagers. C’est souvent au niveau du « premier kilomètre » de l’action publique que surgissent les idées nouvelles. L’enjeu est ensuite de repérer, capitaliser et diffuser ces innovations locales pour qu’elles puissent inspirer d’autres territoires, sans chercher à les copier à l’identique. Cela suppose de mettre en place des dispositifs qui garantissent la possibilité d’expérimenter et d’évaluer. On ne peut pas innover durablement sans savoir si ce que l’on fait fonctionne, ni sans comprendre son impact sur les agents, les finances ou les usagers.
Vous insistez sur la nécessité d’évaluer. Pourquoi ce point est-il si crucial ?
Parce qu’il conditionne la crédibilité de l’innovation publique. Une démarche innovante n’a de valeur que si elle est mesurable, si elle produit des effets tangibles. L’évaluation permet de transformer l’expérimentation en preuve, et la preuve en changement durable. C’est aussi ce qui distingue une idée isolée d’une véritable politique d’innovation. Notre objectif, au CNFPT, est d’aider les collectivités à développer cette culture de l’évaluation, pour que l’innovation ne soit plus perçue comme un gadget ou une mode, mais comme une méthode rigoureuse au service de la performance publique.
Innovation et simplification vont-elles de pair ?
La simplification n’est pas l’inverse de l’innovation : elle en est une forme. Innover, c’est souvent introduire de nouvelles pratiques, ce qui peut sembler complexifier l’action publique. Mais bien pensée, l’innovation vise justement à simplifier la vie des usagers et à rendre les organisations plus lisibles. Attention cependant à ne pas confondre simplification et uniformisation. Le risque, c’est de massifier des réponses qui ne sont pas adaptées à la diversité des situations locales. Simplifier, c’est aussi une transformation culturelle : accepter de renoncer à certaines procédures, faire confiance aux agents, et repenser les chaînes de décision. C’est en ce sens une dimension pleine et entière de l’innovation publique.
Quelle suite pour ces premières Assises ?
Nous allons d’abord approfondir l’analyse des résultats de notre enquête, puis travailler sur trois axes :
1. Poursuivre la construction de réponses concrètes aux problématiques soulevées par les innovateurs ;
2. Adapter notre offre de formation et nos dispositifs de capitalisation au sein du CNFPT ;
3. Renforcer la coopération entre les acteurs publics de l’innovation — CNFPT, DITP, 27e Région, laboratoires territoriaux, etc.
L’enjeu est clair : coordonner nos actions, ancrer l’innovation dans la durée, et mieux relier les besoins du terrain aux apports de la recherche. L’innovation publique n’est pas une lubie : c’est une manière de réaffirmer la mutabilité du service public, en lui donnant les moyens d’évoluer sans se renier.