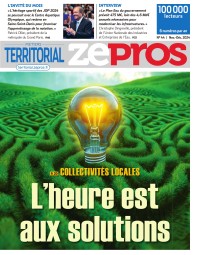« La semaine en quatre jours ne doit pas être un dogme mais une option souple et concertée »

Face aux enjeux d’attractivité, de qualité de vie au travail et de maintien du service public, la semaine en quatre jours suscite un intérêt croissant chez les agents territoriaux. Mais derrière cette demande, les conditions de mise en œuvre sont complexes. Marie-Claude Sivagnanam, DGS de la CA de Cergy-Pontoise et vice-présidente du SNDGCT, nous éclaire sur les enseignements tirés des premières expérimentations.
Pourquoi la semaine en quatre jours séduit-elle autant les agents ?
Parce qu’elle incarne une aspiration forte à davantage de souplesse dans l’organisation du travail. Les agents territoriaux, comme l’ensemble des actifs, recherchent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela peut aussi permettre de dégager un jour pour des démarches personnelles, familiales ou de santé. Cette demande reflète l’évolution des attentes sociétales en matière de temps de travail.
Est-ce facile à mettre en place dans une collectivité ?
Pas vraiment. Contrairement au secteur privé, nous sommes soumis à la règle des 1 607 heures annuelles. Il ne s’agit donc pas, dans notre cas, de réduire le temps de travail mais de le concentrer. Cela suppose des journées plus longues, une organisation des équipes différente, et une compatibilité avec les exigences de service public. D’où la conclusion de notre étude : il vaut mieux parler de semaine modulée plutôt que de semaine de quatre jours.
Quels sont les principaux points de vigilance ?
Le premier, c’est la continuité du service public. La semaine de quatre jours ne doit pas désorganiser les missions. Ensuite, il faut préserver le collectif de travail : éviter que les équipes ne se croisent plus, que les temps d’échanges s’amenuisent. Cela exige un vrai travail managérial. Il faut aussi être attentif aux effets sur la santé des agents, à l’allongement des journées, et à l’égalité femmes-hommes. Certaines femmes, notamment en famille monoparentale, y voient un gain de souplesse. D’autres redoutent un "jour de corvée" en plus. C’est donc très variable.
Disposez-vous déjà de retours d’expérience concrets ?
Oui. Notre étude s’appuie sur de nombreux témoignages de collectivités. Certaines ont adopté une semaine de quatre jours complète, d’autres une semaine alternée (quatre puis cinq jours), d’autres encore des formules hybrides. Ce que nous avons appris, c’est qu’il faut expérimenter, évaluer, ajuster. Et ne pas chercher une solution unique pour tous. Certaines petites collectivités ont sauté le pas plus facilement que des grandes structures. À l’inverse, des grandes collectivités peuvent plus aisément répartir les absences.
Quels sont les leviers pour réussir une mise en place ?
D’abord, un dialogue approfondi entre la direction générale, les élus, les services RH, les organisations syndicales, les médecins de prévention et, bien sûr, les managers. Ensuite, un accompagnement des encadrants est essentiel : ils doivent gérer des collectifs de travail morcelés, tout en assurant un service homogène. Enfin, il faut oser expérimenter sur un temps donné, en commençant par certains services volontaires.
Quels enseignements tirez-vous des expérimentations ?
La clé, c’est l’adaptabilité. Ce qui fonctionne dans une collectivité ne fonctionne pas forcément ailleurs. Le succès dépend des métiers, des attentes des agents, de la volonté politique aussi. Ce n’est pas un sujet uniquement technique : il engage un projet managérial et politique. Et c’est aussi une question d’attractivité. Même lorsque les agents ne choisissent pas la semaine de quatre jours, le simple fait de la proposer est perçu comme un signe de modernité et de confiance.
La semaine de quatre jours est-elle compatible avec le télétravail ?
Cela dépend des choix faits localement. Certaines collectivités autorisent le cumul, d’autres non, notamment pour équilibrer entre agents éligibles et non éligibles au télétravail. Dans certains cas, la semaine de quatre jours est même pensée comme un levier de compensation pour les agents de terrain qui ne peuvent pas télétravailler.
Finalement, s’agit-il d’un modèle d’avenir ?
C’est un outil parmi d’autres. Il ne faut pas en faire un dogme. Mais si l’on veut répondre aux attentes des agents et renforcer l’attractivité du service public local, il faut proposer des organisations du travail plus souples, plus ajustées, plus humaines. La semaine de quatre jours peut en faire partie, à condition d’être pensée collectivement et mise en œuvre avec rigueur.