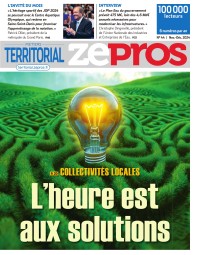Eau : un mur d’investissement se dresse devant les collectivités

Selon le nouvel Observatoire des investissements publics dans le secteur de l’eau publié par la Banque des Territoires, la commande publique reste stable autour de 5,3 milliards d’euros par an. Mais le besoin supplémentaire est estimé à 4,6 milliards d’euros annuels pour entretenir, adapter et préserver les réseaux face au changement climatique. Une équation financière de plus en plus difficile à résoudre pour les collectivités locales.
Depuis 2019, les investissements dans le domaine de l’eau stagnent. L’étude, fondée sur l’analyse de l’ensemble des marchés publics liés à l’eau potable et à l’assainissement, constate un niveau d’investissement stable à 5,3 milliards d’euros par an (7 milliards en incluant les délégations de service public). Une situation préoccupante alors que les besoins augmentent rapidement, en raison du vieillissement des réseaux et de la multiplication des épisodes de sécheresse.
La Banque des Territoires évalue à 4,6 milliards d’euros supplémentaires par an les montants nécessaires pour atteindre un niveau d’entretien et de modernisation compatible avec les enjeux climatiques.
« Le patrimoine bâti et naturel du secteur nécessite plus que jamais une gestion active », alerte Kosta Kastrinidis, directeur des prêts à la Banque des Territoires.
La répartition des compétences entre communes, intercommunalités et syndicats mixtes, issue des transferts opérés en 2020, demeure figée. La suspension de l’obligation de transfert prévue pour 2025 risque d’entretenir cette fragmentation. Résultat : un secteur « très atomisé », avec 85 % des lots inférieurs à 500 000 euros, freinant la massification des projets.
Entre espoir d’accélération et lente maturation des projets
L’étude note toutefois une hausse des marchés publics de prestations intellectuelles : ingénierie, études, assistance à maîtrise d’ouvrage. Ce signal traduit une « montée en connaissance » des collectivités, souvent préalable à de futurs travaux. Près de la moitié des collectivités ayant lancé une étude passent à l’action l’année suivante, confirmant un effet d’entraînement positif.
Reste que sur le terrain, les disparités restent fortes. Le “petit cycle de l’eau” (eau potable, assainissement) concentre 80 % des investissements, tandis que le “grand cycle” (GEMAPI, eaux pluviales) se limite à 20 %, souvent dans les territoires littoraux et fluviaux les plus exposés aux aléas climatiques.
Les projets liés à la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeurent embryonnaires, limités à des études préalables. La Banque des Territoires appelle donc à un sursaut collectif.
Avec son programme Aquagir, elle propose aux collectivités un accompagnement global – de la sensibilisation au financement – pour préserver la ressource « en quantité comme en qualité ».
« N’attendons pas qu’il soit trop tard pour nous jeter à l’eau », conclut Kosta Kastrinidis.