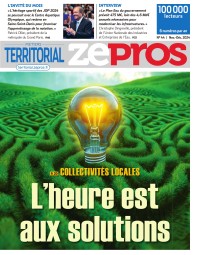Eau potable : qualité, coûts et confiance, les nouveaux défis des collectivités

Alors que la pression monte autour des enjeux sanitaires et environnementaux, les collectivités doivent garantir une eau potable de qualité tout en anticipant la hausse des coûts et la défiance croissante des usagers. Lors d’un point presse organisé en mars dernier, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a dressé un état des lieux complet et alerté sur la soutenabilité du modèle actuel.
La qualité de l’eau du robinet reste globalement conforme aux normes sanitaires, mais la confiance des citoyens s’effrite. Entre les alertes médiatiques sur les polluants, les exigences croissantes de transparence et les incertitudes liées au coût du service, les élus locaux sont confrontés à une triple équation : rassurer, investir et rééquilibrer.
La FNCCR a rappelé le rôle central des collectivités dans la surveillance et la gestion de l’eau potable. Elles s’appuient sur des contrôles sanitaires (ARS), des autocontrôles et des plans de gestion des risques (PGSSE) pour garantir la conformité. Mais de nouveaux défis émergent : la pollution diffuse, les métabolites de pesticides, les PFAS, ou encore le changement climatique, qui fragilise la ressource et complexifie les traitements.
Le coût du service d’eau explose. Avec un coût moyen de 1,85 €/m³ (hors taxes), dont 20 % pour le traitement, les collectivités investissent dans la modernisation des réseaux, la protection des captages et l’adaptation aux normes. La FNCCR estime une hausse des coûts de +50 % dans les dix prochaines années.
Et demain, qui paiera ?
Si les usagers financent déjà l’essentiel via leurs factures, la question du « responsable-payeur » revient avec force. Le principe prévoit d’impliquer les producteurs de polluants, y compris rétroactivement, et de renforcer les redevances sur les produits phytosanitaires, les micropolluants ou les PFAS.
La prévention reste une solution moins coûteuse que le traitement. L’enjeu est aussi agricole : protéger les aires d’alimentation de captage, accompagner la transition agroécologique et limiter les intrants chimiques. La comparaison est frappante : les agences de l’eau mobilisent 100 M€/an pour la prévention, contre 9,4 Md€ pour la PAC.
Mais au-delà des coûts, la confiance vacille. Une enquête de la FNCCR auprès de 100 collectivités (représentant 9 millions d’habitants) révèle une forte hausse des sollicitations des citoyens. Les habitants s’inquiètent des risques sanitaires, réclament des analyses accessibles et expriment leur défiance face aux pollutions émergentes. 65 % des collectivités ont mis en place des moyens d’information, et plus de la moitié ont renforcé leur communication ces six derniers mois.
Pour les élus locaux, l’eau devient donc un sujet politique sensible. Car si l’eau est vitale, sa gestion repose sur un équilibre fragile entre exigences sanitaires, contraintes financières et exigence démocratique.