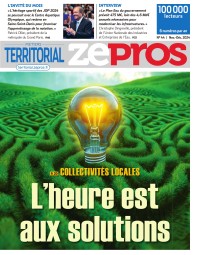Sapeurs-Pompiers : quand la prévention devient une culture du soin collectif

Le Panorama 2025 de Relyens, assureur historique des collectivités, dresse un constat précis sur l’état de santé et la sinistralité dans les services d’incendie et de secours (SDIS). Si la fréquence des accidents reste globalement stable, leur gravité s’accentue et les arrêts de longue durée se multiplient. Face à ce défi, les SDIS expérimentent de nouveaux dispositifs de réathlétisation et de réaccueil pour accompagner les agents dans leur retour à l’emploi et prévenir les rechutes.
L’étude, menée auprès de 49 SDIS représentant plus de 55 000 agents, montre que 64 % des accidents surviennent en caserne, 30 % sur intervention et 5 % sur le trajet domicile-travail. L’activité physique reste la principale cause d’accident dans les centres de secours, tandis que les missions de secours à victime concentrent la majorité des incidents sur le terrain. Ces chiffres rappellent la réalité d’un métier exposé, où l’usure physique se conjugue à la pression psychologique. En moyenne, un arrêt dure 45 jours, un chiffre qui grimpe avec l’âge, tandis que l’âge moyen des sapeurs-pompiers professionnels atteint désormais 43 ans. « Dans un métier aussi exigeant, la question du maintien en activité devient cruciale », souligne Régis Douaud, responsable management des risques chez Relyens.
Une tendance générale contrastée
La fréquence des accidents baisse légèrement chez les professionnels, mais leur gravité augmente. Chez les volontaires, c’est l’inverse : plus d’accidents, mais de moindre intensité. Ce double mouvement traduit l’adaptation progressive du service public d’incendie à des effectifs vieillissants, tout en cherchant à préserver les capacités opérationnelles. La bonne nouvelle vient du recul du taux de rechute, passé de 7,5 % à 4,9 % chez les professionnels et de 4 % à 2,5 % chez les volontaires.
Derrière ces chiffres, une évolution des mentalités : la reprise d’activité n’est plus considérée comme une formalité administrative, mais comme un processus à part entière. Les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) commencent à voir le retour à l’emploi comme un acte de soin collectif, impliquant le commandement, les médecins, les responsables RH et les équipes.
Pour Relyens, la clé réside dans une approche anticipatrice fondée sur trois principes : analyser les risques internes à chaque SDIS, améliorer les conditions de travail et accompagner les parcours individuels. « Le maintien dans l’emploi doit être anticipé, pas subi. C’est une question d’organisation et de culture », rappelle Régis Douaud. Cette philosophie inspire déjà plusieurs services départementaux. Dans la Drôme et l’Ardèche, la sous-direction santé a mis en place un protocole de réathlétisation pour les agents en arrêt long. Évaluations fonctionnelles, suivi nutritionnel, accompagnement psychologique : la reprise est désormais encadrée par une équipe pluridisciplinaire. « Le protocole n’est pas perçu comme une contrainte, mais comme un soutien », explique le docteur Lise Coureau, qui coordonne le dispositif.
Dans le Tarn, la lieutenante Myriam Clément pilote un plan d’accompagnement physique adapté, destiné à sécuriser la reprise progressive des agents. Chaque participant bénéficie d’un programme individualisé, encadré par un éducateur en activité physique. « Prendre soin des agents, c’est aussi prendre soin du service et de sa performance collective », résume-t-elle. Ces initiatives locales partagent une même conviction : la santé des pompiers ne dépend pas seulement du suivi médical, mais de l’attention portée à chaque étape du parcours professionnel, de l’entraînement à la reconversion éventuelle.
Certaines démarches vont plus loin, en intégrant le réaccueil comme un levier managérial. Au SDIS de la Haute-Marne, Jennifer Cancelas a fait du retour à l’emploi un axe prioritaire de la politique de ressources humaines. Pour elle, un retour mal préparé fragilise autant l’agent que l’organisation. Le dispositif qu’elle déploie repose sur le maintien du lien pendant l’arrêt, une évaluation partagée avant la reprise, un accompagnement psychologique et un suivi post-retour. « Il faut dépasser les pratiques au cas par cas pour bâtir une politique claire, intégrée à la démarche santé et qualité de vie en service », explique-t-elle.
Cette approche globale du « triangle du réaccueil », articulant santé, performance et management, inspire de plus en plus de SDIS. Elle repose sur un principe simple : garantir la santé et la sécurité des personnels, c’est aussi investir dans la continuité du service public rendu aux populations. Une logique de prévention partagée, défendue par Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises : « Accompagner la reprise, prévenir les rechutes, promouvoir la santé physique comme mentale, c’est une responsabilité collective. »
Pour Relyens, cette mutation va bien au-delà de la gestion des risques : elle traduit une évolution culturelle du service public. L’assurance n’est plus un filet de sécurité mais un partenaire de transformation, capable d’accompagner les SDIS dans leurs politiques de prévention et de santé au travail. Comme le résume Armelle Magat, directrice du marché SDIS chez Relyens, « préserver les femmes et les hommes du feu, c’est garantir la performance et la pérennité du service public de secours ».
L’innovation, ici, n’est pas technologique mais humaine : une innovation du soin, du collectif et de la responsabilité partagée. Les pompiers apprennent à se protéger les uns les autres, pour continuer à protéger les autres.