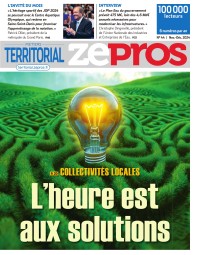Mobilité : sortir de l’impasse, repenser l’équité

Dans une étude conjointe, l’Agence France Locale (AFL) et l’Institut national des études territoriales (INET) appellent à une refonte ambitieuse du financement des mobilités du quotidien. Objectif : décarboner les transports sans creuser les inégalités territoriales et sociales.
La France doit concilier deux impératifs : décarboner ses mobilités pour répondre à l’urgence climatique, tout en corrigeant les inégalités croissantes d’accès aux transports. C’est le défi qu’entendent relever les auteurs de l’étude AFL-INET 2025, fruit du travail de neuf élèves administrateurs et ingénieurs en chef territoriaux de l’INET, sous la supervision de l’AFL, du Cerema et d’I4CE.
Les constats sont clairs : « La donne actuelle des mobilités est défavorable au climat et à la cohésion sociale », soulignent les auteurs. Le modèle dominant, hérité des Trente Glorieuses, repose sur la voiture individuelle, au détriment des territoires ruraux, périurbains ou ultramarins. Résultat : une dépendance aux carburants fossiles, une fracture d’accès aux services, une mobilité à deux vitesses.
Un modèle de financement à bout de souffle
Au cœur du problème : un financement local de la mobilité jugé inadapté. Les ressources des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ne permettent pas de couvrir les besoins croissants, en fonctionnement comme en investissement. Et ce, dans un contexte de forte tension budgétaire pour les collectivités. L’étude rappelle que « financer une mobilité durable et équitable nécessitera de réallouer certaines dépenses aujourd’hui consacrées aux mobilités brunes, et de créer de nouvelles recettes ». Autrement dit : rediriger les investissements, notamment vers les transports collectifs et les mobilités actives, dans tous les territoires, y compris les plus ruraux.
Des fractures sociales et territoriales béantes
Les inégalités de mobilité ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi sociales. L’étude souligne que 28 % des adultes en France sont en situation de « précarité mobilité », souvent contraints d’habiter loin des centres urbains pour des raisons de coût du logement, tout en restant dépendants de la voiture.
Or, les aides publiques à l’achat de véhicules propres restent insuffisantes pour ces ménages. Le bonus écologique a été réduit, passant de 7 000 euros en 2021 à 4 000 euros en 2025. En parallèle, « la transition doit respecter des critères d’acceptabilité sociale », plaident les auteurs, en s’appuyant notamment sur les recommandations de l’ADEME : accompagnement de proximité, équité, existence de solutions alternatives avant toute coercition.
Des leviers pour une mobilité plus juste
Face à ces constats, les auteurs avancent plusieurs pistes de réforme. Ils plaident pour une gouvernance renforcée de la mobilité, appuyée par une coopération accrue entre collectivités et proposent également de différencier les modèles de financement selon les contextes territoriaux, afin d’adapter les réponses aux réalités locales.
Des exemples inspirants sont déjà cités, comme les navettes solidaires mises en place dans la communauté de communes du Clunisois, en Saône-et-Loire, pour permettre à des personnes âgées isolées d’accéder aux services de base. L’enjeu est bien de développer des solutions souples et de proximité, telles que le transport à la demande ou la mobilité solidaire.
Une urgence sociale et écologique
En conclusion, l’étude rappelle que « la décarbonation des mobilités est un enjeu d’équité territoriale, sociale et d’égalité des chances ». Elle appelle à faire de la mobilité un levier de résilience et de cohésion, au service des habitants et des territoires.
https://www.agence-france-locale.fr/app/uploads/2025/04/etude-inet-afl-2025_v4_compressed.pdf