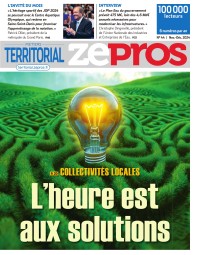Responsabilité financière : flou juridique et insécurité pour les cadres territoriaux

Depuis la réforme de 2022, les gestionnaires publics peuvent être mis en cause à titre personnel sur le plan pénal, administratif et financier sans même que leur responsabilité soit clairement définie. Hélène Guillet, présidente du SNDGCT (Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales), dénonce une "automatisation" des premières jurisprudences et appelle à une clarification tenant compte des réalités de l'action publique.
Vous avez lancé une alerte sur la responsabilité financière des gestionnaires publics. Quel est le problème principal que vous soulevez aujourd'hui ?
Nous ne remettons pas en cause le principe de responsabilité ou de transparence dans la gestion publique. Il est normal que les décideurs rendent compte de leurs actes. Mais les récentes jurisprudences autour du régime de responsabilité font peser sur les gestionnaires publics une pression sans précédent. Le problème, c'est qu'ils peuvent désormais être sanctionnés de manière automatique pour des décisions de gestion ou simplement des erreurs qui n’ont rien à voir avec une faute grave ou une malveillance. Il peut s'agir de simples retards, de maladresses administratives, d’incapacité à faire ou d'interprétations différentes de la règle. Or, ces mises en cause individuelles, sans soutien juridique possible, sont vécues comme une injustice et un facteur de grande insécurité professionnelle.
Qu'est-ce que la protection fonctionnelle, et pourquoi est-elle ici refusée ?
La protection fonctionnelle est un principe fondamental dans la fonction publique. Elle permet à un agent ou un dirigeant, à un élu aussi d'être défendu et accompagné juridiquement par sa collectivité lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions. Cela vaut, par exemple, en cas d'agression verbale ou physique, ou de mise en cause pénale. Mais dans le cadre du nouveau régime de responsabilité financière, cette protection est explicitement exclue. Cela signifie que le gestionnaire, même s'il a agi avec bonne foi et dans l'intérêt du service public, doit se défendre seul, sans aide juridique ni prise en charge des frais. C'est un bouleversement profond et inacceptable dans la manière de considérer l'engagement des agents publics.
Pourquoi dites-vous que le cadre actuel est flou ?
Parce que les textes ne définissent pas clairement le périmètre de responsabilité des directions générales. Contrairement à d'autres secteurs (santé, associatif...), où les rôles sont encadrés, les DGS ne savent pas toujours sur quels actes précis leur responsabilité peut être engagée. Cela engendre une grande insécurité juridique, source de blocages et d'inertie dans les services.
Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'action publique ?
Elles sont majeures : déresponsabilisation, ralentissement des décisions, paralysie de l'action, peur de l'erreur... Les DGS peuvent être tentés de tout faire valider par les exécutifs locaux ou les assemblées, ce qui complexifie inutilement l’action publique. Certains risquent aussi de renoncer à exercer leurs missions. Cela affecte la qualité du service public et compromet l'innovation dans les territoires.
Que propose le SNDGCT ?
D'abord, que le recours à la protection fonctionnelle soit rendue possible pour les gestionnaires publics. Ensuite, que l'on se mette autour de la table pour redéfinir clairement le champ de responsabilité des DGS. Nous voulons une réforme qui respecte les principes de la responsabilité publique, mais qui soit aussi adaptée aux réalités du terrain.
Le rapport Vigouroux va-t-il dans ce sens ?
Oui. Il confirme nos alertes : il faut tenir compte des missions, des compétences et des moyens réels avant de sanctionner. Il appelle à une approche de bon sens. Nous partageons cette analyse et nous sommes prêts à co-construire des solutions avec l'État et les partenaires territoriaux.
Cette alerte est-elle préventive ou y a-t-il déjà des cas concrets ?
Il y a déjà des cas jugés et d'autres en cours. Nous sommes en phase d'observation, mais l'émergence de ces situations nous oblige à réagir. Nous voulons éviter que ces mises en cause se multiplient. Je demande des mesures concrètes et rapides.
Un mot pour conclure ?
Nous ne refusons pas nos responsabilités. Mais il faut donner aux secrétaires généraux et aux directions générales des collectivités locales des outils de sécurisation. Il en va de l'efficacité, de l'attractivité et de la justice dans l'exercice des missions publiques.